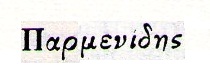
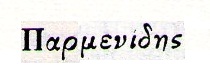
PARMENIDE ou Des Idées.
Œuvre de Platon (428?-347 av. J.-C).
. . . Dialogue philosophique de Platon, appartenant au groupe dit de la vieillesse (v. Théétète, Sophiste, Politique, Philèbe, Timée et Lois), où le philosophe athénien reprend les thèmes fondamentaux de sa pensée, maintenant élaborée, et les soumet à un sévère examen critique et autocritique rarement éclairé par une conclusion mais, précisément pour ce fait, singulièrement dramatique. Ce dialogue, qui met en scène trois principaux interlocuteurs : Zénon, Socrate, encore jeune, et Parménide, ne nous est pas présenté directement : un dénommé Céphale nous transmet le récit que lui fit jadis Antiphon. Selon ce récit, Socrate, qui faisait alors ses premières armes, s'était rendu, en même temps que d'autres, chez Pithodore pour assister à la lecture d'un essai de Zénon : dans cet écrit, le célèbre disciple des Eléates démontrait l'inexistence du multiple. La lecture était presque terminée lorsque survint Parménide, le plus illustre représentant de la philosophie d'Elée, accompagné de Pithodore et du jeune Aristote. Socrate fait tout de suite une objection à l'essai de Zénon : démontrer l'inexistence du multiple, c'est, au fond, démontrer, comme le voulait Parménide, que seule l'unité absolue existe. Mais Zénon n'a pas voulu faire concurrence à son maître : il a seulement voulu démontrer que si l'affirmation de l'Unité éternelle et immobile porte en soi de nombreuses contradictions, l'affirmation de la multiplicité en entraîne autant. De toutes façons, réplique Socrate, Zénon a borné son étude aux seuls objets sensibles, toujours changeants et relatifs ; sa démonstration aurait été décisive s'il avait d'abord considéré les valeurs intelligibles, la Similitude, la Dissemblance, l'Unité, la Pluralité en elles-mêmes, et s'il avait ensuite démontré l'impossibilité d'une co-existence de ces valeurs, en mettant, en évidence les contradictions qui proviennent de leur multiplicité. A ce moment, Parménide intervient : l'objection de Socrate est certainement fondamentale ; cependant la théorie sur laquelle il se fonde n'est pas dénuée de points obscurs. Socrate, en effet, divise la réalité en deux mondes, l'un constitué de pures formes intelligibles, les Idées, existant en soi et éternelles, l'autre formé d'objets sensibles, et réels seulement en ce qu'ils participent des formes intelligibles. Il y a donc l'homme particulier et l'Idée absolue d'homme, le feu matériel et l'Idée absolue de feu, la boue et l'Idée de boue, etc. Et l'homme particulier est homme en ce qu'il participe de l'Idée d'homme, le feu en ce qu'il participe de l'Idée de feu..... Mais que signifie participer ? Et comment tant d'hommes peuvent-ils participer de l'unique Idée d'homme, tant de feux de l'unique Idée de feu ? Si l'on considère l'Idée comme un voile unique qui recouvre une multiplicité de choses, celles-ci ne participeront pas de l'Idée complète, mais seulement d'une de ses parties ; si nous la concevons comme une pensée se rapportant à de nombreux objets, il est clair qu'une pensée ne peut être que pensée de quelque chose et plus particulièrement de cet unique aspect qui se révèle commun dans les différents sujets : cet aspect commun est la forme même qui devient ainsi pensée de la pensée, et son contact avec les objets est donc impossible. Si enfin nous admettons que l'Idée est un modèle des choses, le rapport entre ces dernières et l'Idée sera un rapport de ressemblance ; mais la Ressemblance est à son tour une Idée de laquelle les choses doivent participer, moyennant un nouveau rapport de ressemblance et ainsi jusqu'à l'infini. Une objection encore plus grave est que ces deux mondes, ainsi conçus, n'ont pas la possibilité de se connaître ; en effet, des objets sensibles, d'une part, et des Idées, de l'autre, constituent deux séries de rapports indépendants entre eux. Par exemple, le maître est tel parce qu'il a un esclave et l'esclave parce qu'il a un maître ; également l'Idée de maître sera telle par rapport à l'Idée d'esclave et vice versa, mais ces deux ordres de rapports n'ont aucun lien entre eux : l'Idée de maître ne commande pas à l'esclave, et pas davantage le maître, à l'Idée d'esclave. Semblablement, la connaissance sensible sera telle par rapport aux objets sensibles connus et l'Idée de connaissance sera également telle par rapport aux Idées connues ; mais la connaissance sensible ne pourra s'étendre aux Idées, pas plus que l'Idée de connaissance ne pourra s'étendre aux objets : l'homme ne pourra connaître Dieu, et Dieu ne pourra connaître l'homme. Il semble donc que Parménide a détruit la théorie des Idées et le jeune Socrate ne sait que répondre.
. . . Cependant le même Parménide affirme, arrivé à ce point du raisonnement, que si nous n'admettons pas l'existence d'Idées universelles, la pensée marquera de tout point d'appui et ne pourra en aucune façon se manifester. C'est alors lui-même qui indique le moyen d'en sortir. En effet la théorie est apparemment détruite par une erreur dialectique que Zenon avait évitée dans son essai, tout en étant tombé à son tour dans l'erreur de se rapporter aux seuls objets sensibles : pour connaître la vérité de quelque chose, il ne suffit pas en effet de considérer les conséquences qui dérivent de l'avoir pensée comme existante, mais il faut examiner aussi celles qui découlent de la penser comme inexistante. Si le fait d'avoir pensé les Idées comme existantes a fait naître une série de contradictions insurmontables, il est probable que si l'on avait considéré les Idées comme inexistantes, on serait arrivé au même résultat. Parménide en étant prié par les auditeurs, donne alors un essai de sa dialectique, apportant ainsi à la théorie de Socrate le même appui que Zénon, dans l'essai qu'il avait lu peu de temps auparavant, avait apporté à la sienne. L'objet de sa discussion sera ce même fameux principe : l'Un. Il considérera d'abord les conséquences qui découlent de l'Un et de ce qui n'est pas l'Un considéré comme existant, puis celles qui en dérivent si on le considère comme inexistant. L'Un, considéré en soi, comme unité pure, ne peut avoir de parts, ni de limites, ni de forme, ni de mouvement (car le mouvement est un changement, et présuppose donc le multiple), ni immobilité (n'étant pas dans quelque chose différent de lui, il ne peut point y rester) ; il ne participe donc point de l'être, ni du devenir, il s'annule en soi-même. Et si nous pensons que 1'« Un est », nous en arrivons à former une dualité d'« Un » et d'« Être », et de ces deux parties, l'Un devra à son tour être, et l'Être devra à son tour être Un, et ainsi de suite à l'infini : l'expression : l'« Un est » se subdivise par conséquent en une infinie multiplicité. D'autre part, si nous admettons que l'Un est, tout ce qui n'est pas un devrait être conçu comme ensemble de parties et chaque partie comme ensemble d'autres parties, à l'infini. Et puisqu'une partie est telle en tant que partie d'une unité, chaque partie participerait à la fois de l'unité et de la multiplicité, en continuelle contradiction avec soi- même. Si nous admettons une Unité pure, tout ce qui n'est pas cette unité ne peut participer d'elle en aucune façon et donc ne pourra même pas être multiple, ne pourra avoir aucun rapport, et se dissoudre en une pure inconsistance. Admettre l'Un signifie donc le considérer à la fois comme un et multiple, comme existant et non existant, lui attribuer en somme tous les attributs opposés et en même temps les lui refuser tous. Si, ensuite, nous admettons l'existence de l'Un, nous apercevons que nous ne pouvons même pas concevoir ce qui n'est pas Un. En effet, si l'Un n'existe pas, ce qui n'est pas Un ne pourra être différent de lui, qui est inexistant : il y aurait donc une multiplicité d'êtres différents entre eux, c'est-à-dire entre 1'« Un » et 1'« autre » : mais cela n'est pas possible parce que l'Un n'existe pas. Et la multiplicité même, comme tout ce qui est conditionné par l'Un, la grandeur, la limite, etc.. n'existera pas. En conclusion, que nous admettions l'Un comme existant, ou que nous l'admettions comme inexistant, nous nous trouvons en face de contradictions insurmontables. Le dialogue s'arrête ici. Parménide est peut-être le dialogue de Platon qui a rendu la critique le plus perplexe. On a même été jusqu'à penser que Platon a voulu s'y élever contre des interprétations partiales de sa théorie et qui la déformaient, ou encore qu'il s'y est lancé à fond dans une autocritique impitoyable de sa pensée. - T.F. Les Belles-Lettres, 1950.
| artmartial.com |