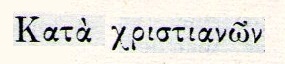
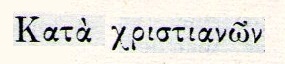
Contre les chrétiens
Œuvre de Porphyre
. . . Ouvrage du philosophe néo-platonicien Porphyre (232?-303), écrit vers l'an 270. « L'ouvrage le plus important et le plus scientifique qui ait été écrit pendant l'antiquité contre le christianisme » (Harnack). Il a été composé, semble-t-il, pour seconder l'effort de l'empereur Aurélien qui désirait restaurer l'unité religieuse de l'État. Indirectement il prend la défense de l'école de Plotin. Largement utilisé, mais rarement cité dans le camp de l'hellénisme, il a été combattu par Méthodius d'Olympe, par Eusèbe de Césarée, par Apollinaire de Laodicée, par Drepanius Pacatus, et peut-être par Philostorgios. Constantin qui voulut faire disparaître tous les « livres impies » en détruisit l'original. Théodose II et Valentinien détruisirent à leur tour les derniers exemplaires. Toutefois, si les documents eux-mêmes nous font défaut, nous pouvons trouver chez Macaire de Magnésie, saint Jérôme, saint Augustin et chez d'autres écrivains, de nombreuses citations qui nous permettent de reconstituer l'ouvrage de Porphyre dans ses grandes lignes. Quinze livres le composaient.
. . . Nous ne pouvons avoir une idée de la méthode et des arguments employés par l'auteur de Contre les Chrétiens qu'en nous référant a une centaine de fragments. Ils se présentent avant tout comme une critique de la personne de Jésus. La responsabilité des « ingénuités », des « fausses prédictions », des « contradictions » qui lui sont attribuées dans les Évangiles, n'incomberait qu'aux Évangélistes. Ni « Logos », ni « Créateur du monde », Jésus a été incapable pendant sa vie de prouver sa mission et d'empêcher, après sa mort, le martyre de tant de ses disciples. Il semble toutefois que, dans l'ensemble, la personnalité de Jésus, bien qu'inférieure à celle du « véritable thaumaturge et philosophe » Apollonius de Tyane, ait inspiré à Porphyre un certain respect. Les Évangélistes, au contraire, sont considérés par lui comme « des faussaires, des menteurs, des manipulateurs de fables destinées aux femmes, aux enfants, et bonnes à faire dormir debout ». Ils n'ont rien de commun avec les véritables historiens. Porphyre relève contre eux les nombreuses erreurs et contradictions contenues dans les Évangiles qu'il affirme connaître parfaitement. Les disciples de Jésus et les premiers apôtres (Pierre et Paul en particulier) sont les plus attaqués. Les critiques qui seront soulevées dans les siècles suivants contre le Fondateur du christianisme, contre ses disciples et ses continuateurs, se trouvent entièrement déjà dans Porphyre qui passe au crible le « Nouveau Testament », chapitre par chapitre, verset par verset. Porphyre critique ensuite les dogmes et les pratiques religieuses des communautés chrétiennes de son temps. Son monothéisme, son platonisme et son stoïcisme lui font trouver, il est vrai, de nombreux liens avec elles. Toutefois, pour Porphyre, « ciel et terre » sont éternels. La « fin du monde » est pour lui une fable comme celle de la « résurrection des corps », l' « incarnation de Dieu », etc. L'unique salut est celui qu'apporte l'enseignement de la sagesse et des règles pour se libérer des passions. Les rites chrétiens ne servent à rien, puisque leurs mythes ne valent pas ceux des Grecs. Les chrétiens sont donc des barbares, des révolutionnaires, des ennemis du passé et de l'ordre établi, de la pensée et de la civilisation helléniques, des hypocrites qui opposent aux vices des païens des vertus ascétiques qu'ils sont loin de posséder. Porphyre cependant ne peut contester la rapide et prodigieuse diffusion du christianisme, ni l'invincible fermeté de ses martyrs.
. . . Pour ce qui est de son originalité, on peut dire de cet ouvrage, et bien que de nombreux passages rappellent les polémiques antichrétiennes des siècles antérieurs et spécialement le Discours véritable de Celse, que trois aspects nouveaux y sont développés : la critique entreprise par l'auteur n'est pas étroitement polémique et demeure toujours élevée et philosophique, c'est un débat d'idées ; de plus, elle s'appuie sur un sérieux appareil scientifique et une connaissance objective des sources chrétiennes ; ce n'était donc pas seulement une discussion serrée et haineuse, telle qu'on pourrait le penser d'après les fragments ; le ton de la discussion y est moins agressif que chez les autres polémistes. « Si Celse est le Voltaire du paganisme. Porphyre en est plutôt le Renan » (P. Allard). L'énorme réaction que suscita dans les milieux chrétiens et intellectuels cet ouvrage, n'a eu d'égal que l'énorme faveur de l'Abstinence de la chair auprès des milieux monastiques et, durant tout le Moyen-Age scolastique, l'Introduction aux catégories ainsi que la fameuse Isagoge (*), propédeutique fondamentale à la philosophie, à la théologie et même à la vie spirituelle. — T.F. Les Belles-Lettres, 1949.
Isagoge
De la vie de Pythagore
| artmartial.com |