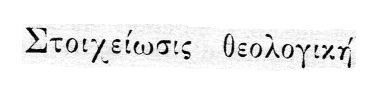
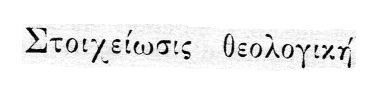
Eléments de Théologie
de Proclus.
. . . C'est un ouvrage d'une importance capitale dans lequel Proclus (410-485), l'un des derniers élèves de l'école d'Athènes et l'un des plus illustres maîtres de l'école néo-platonicienne, recueille et résume les idées essentielles du néo-platonisme. Le chef de cette école, Plotin, avait énoncé en termes généraux que le Nombre procédait de l'Unité et retournait à l'Unité. Proclus distingue les moments de ce processus et en applique systématiquement le plan à toutes les parties de sa doctrine. La loi de l'unité est de produire par elle-même une multiplicité sans se diviser et se multiplier elle-même ; elle l'engendre parce qu'elle la contient en soi d'une façon éminente. Le produit, considéré comme distinct du producteur, provient de lui ; mais, comme semblable, il demeure partiellement en lui et y retourne comme à son bien. Chaque être engendre donc de lui-même des êtres inférieurs à lui, qui ont en eux quelque chose de lui et aspirent à revenir à lui. Le produit, sorti du producteur, y demeure, y retourne. C'est la loi de la création cosmique par laquelle le Nombre provient de l'Unité. Plus l'on descend dans la série de la production, plus l'être est divisé, complexe, imparfait ; plus on s'élève, plus l'être est simple, un et parfait. Cette loi, Proclus l'applique à toutes les sphères du monde intelligible et sensible, avec une minutie pédagogique. A ces entités métaphysiques il fait correspondre un ordre de divinités, ou êtres surnaturels du polythéisme, dont il tend à faire une pure allégorie. Il faut remarquer chez lui l'irruption d'un élément irrationaliste : l'âme ne s'unit pas à l'Unité par la pensée, mais par une faculté spéciale, supérieure à la pensée, qui est la foi ou l'enthousiasme ou la folie. Par sa concision et sa clarté, cet ouvrage de Proclus connut une grande vogue, surtout au Moyen-Age, dans la forme abrégée que lui avait donnée un Arabe et qui circula sous le titre Liber de causis, dans la traduction latine due, croit-on, à Gérard de Crémone. Le Liber de causis fut commenté par Albert-le Grand, saint Thomas et Egidio Colonna.
HYMNES
de Proclus.
. . . Ces Hymnes (au nombre de six) du philosophe néo-platonicien Proclus de Constantinople (Ve siècle ap. J.-C.) sont dédiés aux divinités païennes. Ils ont beaucoup de traits communs, — quant à leur forme et à leur fond, — avec les plus anciens Hymnes homériques (*) et orphiques, et avec les Hymnes (*) de Callimaque ; mais ils portent le cachet hautement spirituel de la personnalité du poète-philosophe qui les a composés. Ils sont respectivement consacrés au Soleil, à Aphrodite, aux Muses, à Hécate, à Janus et à Athéna ; le plus long et le plus complexe est l'hymne à Athéna. La première partie de chaque hymne comprend une louange du dieu célébré ; vient ensuite une prière dans laquelle le poète, loin de demander les richesses, la gloire ou les honneurs, demande de pouvoir être exempt de fautes et de passions, de façon à pouvoir être admis à la contemplation du divin. Les Hymnes de Proclus sont animés par la chaleur d'une foi sincère. La forme, qui se rapproche du genre épique, est riche — comme le langage poétique de l'époque — de termes archaïques et scientifiques. Dans la langue comme dans la technique de l'hexamètre, l'influence de Nonnos est évidente.
| artmartial.com |