
Taiji
Quan : Art martial - Technique de longue vie
de Catherine
Despeux
Extrait : chapitre 1. HISTORIQUE
"Lorsqu'au lever du jour, l'on voit les Chinois pratiquer le Taiji quan
dans les parcs, l'on pense au premier abord qu'il s'agit d'une danse, tant les
mouvements sont exécutés avec grâce et lenteur dans un enchaînement
ininterrompu. Cependant, tant d'un point de vue historique que par l'analyse
du terme, c'est dans les arts martiaux qu'il convient de placer le Taiji quan,
du moins à son origine. Le terme Taiji quan signifie en effet littéralement
« Boxe du Faîte Suprême ».
Les techniques de combat à main nue ont été classées
en deux écoles : l'école exotérique (waijia) et l'école
ésotérique (neijia). C'est dans cette dernière que l'on
classe généralement le Taiji quan, avec deux autres techniques
intitulées « Boxe du corps et de la pensée » (xingyi
quan) et « Boxe des huit trigrammes » (bagua quan). Ces deux écoles
sont rattachées à deux centres religieux célèbres
de Chine : le temple Shaolin (1), grand centre du bouddhisme chan (Zen) et le
mont Wudang (2), centre taoïste très florissant à partir
de la dynastie des Song. Les maîtres parlent donc indifféremment
d'école exotérique et école ésotérique ou
bien de courant Shaolin et courant Wudang.
(1) Le temple Shaolin est situé sur le mont Shaoshi, au
nord-ouest du district Dengfeng et non loin de Luoyang dans la province du Henan.
Il a été construit à la fin de la dynastie des Wei... Un
des murs du fond du temple comporte des fresques représentant les moines
du temple Shaolin exécutant des exercices de boxe... Ce temple fut jusqu'à
récemment un centre vivant de bouddhisme et d'arts martiaux...
(2) Le mont Wudang est situé dans le nord-ouest de la province du Hubei.
Le massif, comportant douze pics, recelait de nombreux temples, dont l'accès
était difficile. C'est pourquoi l'empereur Yongle (XV' siècle)
fit tailler dans le roc une montée. "
1. L'ÉCOLE EXOTÉRIQUE
Cette catégorie comprend la plupart des techniques de combat assez violentes,
du genre de ce qu'on appelle en France le gongfu. Mais la plus prestigieuse
d'entre elles reste la Boxe du Shaolin (Shaolin quan).
Le temple Shaolin est situé dans le nord-ouest de la province du Henan,
non loin de la ville de Luoyang et près du district Dengfeng. Il aurait
été édifié par Foto (Buddhajiva), moine venu de
l'Inde, la dixième année de l'ère Taihe, soit en 495. Ce
temple, point de départ du bouddhisme chan en Chine, doit aussi
sa célébrité à une solide réputation de centre
d'arts martiaux.
Les différents écrits historiques du bouddhisme présentent
Bodhidharma comme l'introducteur du bouddhisme chan en Chine et comme
le premier patriarche de cette école dans l'empire du Milieu. On raconte
qu'il aurait séjourné au temple Shaolin et y serait resté
neuf ans assis en méditation face à un mur. Ce personnage pose
des problèmes, car les différentes sources le concernant divergent
: certaines le considèrent comme un moine perse, d'autres comme indien,
et les dates de son arrivée en Chine varient de 479, voire antérieurement,
à 526. Cela a permis à certains chercheurs de mettre en doute
l'existence de Bodhidharma, tandis que d'autres ont suggèré qu'il
pouvait s'agir d'un groupe de moines indiens. Toujours est-il que le nom de
Bodhidharma fut par la suite définitivement lié à celui
du temple Shaolin et on lui attribua la création d'une technique de combat.
Il est ainsi courant en Chine que l'on attribue à un personnage célèbre
la création d'une technique afin de lui donner du prestige.
Dans le milieu contemporain des arts martiaux, on attribue également
à Bodhidharma deux traités de techniques corporelles : le Traité
d'assouplissement des muscles (Yi jin jing) et le Traité du lavage
de la moelle épinière (Xi sui jing). De ce dernier traité,
il n'existe aucune trace écrite. Par contre, un Yi jin jing est
inséré dans le Neigong tushuo, ouvrage de la dynastie des
Ming. Il existe un autre traité du même titre attribué à
Li Jing, célèbre général de la dynastie des Tang
(618-906). Selon Xu Zhedong, Chinois contemporain auteur de recherches sur l'histoire
des arts martiaux, ce demier ouvrage serait un apocryphe de la dynastie des
Qing (1644-1912).
Si l'on ne peut considérer Bodhidharma comme l'initiateur du Shaolin
quan, et de fait aucune de ses biographies ne le mentionne comme l'introducteur
d'une technique de combat ou de techniques corporelles, du moins ne peut-on
écarter l'hypothèse d'une influence des techniques corporelles
indiennes et de l'introduction de celles-ci au temple Shaolin, soit au temps
de Bodhidharma, soit plus tardivement. En effet, nous savons que des techniques
corporelIes indiennes ont été introduites en Chine ; le chapitre
bibliographique de l'Histoire des Sui comporte les titres de plusieurs
de ces ouvrages qui semblent perdus.
Le rôle du temple Shaolin en tant que centre d'arts martiaux est déja
attesté vers la fin de la dynastie des Sui (589-618), et dès lors
les moines guerriers du temple Shaolin vont constamment apparaître sur
la scène historique. Ainsi, vers 619, cinq mille moines se soulevèrent
à Huairong (Mongolie), sous la conduite, du moine Gao Tancheng. Sous
le règne de Li Shimin, fondateur de la dynastie des Tang, ce même
moine Tancheng et treize autres du temple Shaolin participèrent à
la répression de la rebellion de Wang Shichong (6). Les moines du temple
Shaolin s'illustrèrent aussi sous les Song, les Ming, les Qing, et furent
très actifs lors de la révolte des boxeurs au siècle demier.
A l'heure actuelle, le Shaolin quan se compose essentiellement de cinq exercices
: la technique de combat du dragon (long quan), la technique du tigre
(hu quan), la technique de la panthère (bao quan), la technique
du serpent (she quan) et la technique de la grue (he quan) (7).
(6) Dans « Le bouddhisme et la guerre », article
écrit par P. Demieville et publié dans Mélanges de l'Institut
des Hautes Etudes chinoises, l'auteur cite plusieurs des mérites
militaires des moines guerriers du temple Shaolin. D'après une inscription
Tang conservée dans ce temple, Li Shimin, le futur empereur Taizong (627-641),
aurait adressé un message aux gens du Shaolin, les exhortant à
maitriser le général rebelle Wang Shichong.
(7) Certains Chinois rapprochent ces techniques du « Jeu des cinq animaux
» (wu qin xi) technique corporelle attribuée au célèbre
médecin Hua To de l'époque des trois Royaumes (222-264), destinée
à écarter les maladies et prolonger la vie. Toutefois, les cinq
animaux sont differents.
2. L'ÉCOLE ÉSOTERIQUE. ORIGINE LÉGENDAIRE DU TAIJI QUAN
Le mont Wudang est situé dans la province du Hubei (nord-ouest). Il acquit
sa célébrité surtout à partir de la dynastie des
Song, lorsqu'un culte a la divinité taoïste Zhenwu ou encore Xuandi,
divinité de la guerre liée au nord (8), s'y développa.
Dès les Han cette divinité, l'« Empereur noir » (Xuandi)
ou le « guerrier véritable » (Zhenwu), a été
associée au boisseau du nord et à I'étoile polaire, localisation
cosmographique du Taiji. L'école taoïste du mont Wudang a développé
toute une série de rituels militaires destinés à combattre
les démons et les influences maléfiques lors de cérémonies
de combat à main nue ou avec des armes. Par ailleurs ces rituels d'exorcisme
sont très souvent liés au Taiji.
Au mont Wudang est étroitement associée la personnalité
du taoïste Zhang Sanfeng (9), qui aurait vécu sous les Song du Sud
(1127-1279) ou plus tard. C'est cet éminent personnage, que l'on présente
généralement comme le créateur du Taiji quan. En effet,
si l'on interroge les maîtres sur l'origine de cet art, ils content pour
la plupart l'histoire suivante : un jour que l'ermite Zhang Sanfeng était
à la fenêtre de sa hutte sur le mont Wudang, son attention fut
attirée par le cri étrange d'un oiseau. Se penchant, il vit une
pie (10) effrayée descendre d'un arbre au pied duquel se trouvait un
serpent. Un duel s'ensuivit, et la pie fut vaincue par le serpent, ce dernier
combattant en souplesse et avec des déplacements curvilignes. Zhang Sanfeng
comprit alors la suprématie de la souplesse sur la rigidité, l'importance
de l'alternance du Yin et du Yang, et d'autres conceptions formant la base du
Taiji quan ; c'est à la suite de cet incident qu'il élabora le
Taiji quan, application des principes du Taiji (11). Cette histoire rappelle
étrangement celle de l'invention du pas de Yu, relatée dans nombre
de textes taoïstes (12) : ce célèbre démiurge, qui
a dompté les eaux, organisé le monde et l'a divisé en neuf
sections grâce à sa danse, à son pas sautillant, aurait
inventé ce pas après avoir vu un oiseau tourner autour des arbres
et des pierres pour attraper des serpents : le thème est ici l'inverse
de celui de la légende de Zhang Sanfeng.
Selon une autre légende, Zhang Sanfeng aurait reçu cette technique
en rêve. On peut lire en effet dans le Ningbo fuzhi (13) : «
Songxi aidait les gens et excellait dans le combat à main nue, il avait
pour maître Sun le treizième vénèrable, qui disait
détenir sa méthode de Zhang Sanfeng de la dynastie des Song...
Une nuit, Zhang Sanfeng reçut en rêve de l'Empereur Noir (Xuandi)
une méthode de combat à main nue ; le lendemain au réveil,
il put à lui seul tuer plus d'une centaine de bandits. »
Il est intéressant de noter les conceptions des Chinois sur la création
d'une chose ou d'une technique. Il ne s'agit pas d'inventer quelque chose de
nouveau, mais la plupart du temps de retrouver un modèle mythique ancien,
qui peut être situé à des temps reculés, une sorte
d'âge d'or, par exemple au temps des empereurs Huangdi et Shennong, ou
comme ici au temps de Yu le Grand. Ce modèle peut être situé
dans un domaine nouménal, et être révélé aux
personnes qui en sont dignes soit par une divinité, soit par des immortels
taoïstes que l'on rencontre un jour et qui disparaissent aussitôt.
Le plus souvent, il s'agit donc d'une redécouverte, voire d'une révélation,
qui se fait en plein jour ou par l'intermédiaire du rêve.
Il en résulte que l'atteinte à une connaissance comporte des années
de pratique, mais le passage à la maîtrise totale de l'art a un
caractère subit, et est souvent suscité par un évènement
extérieur en apparence insignifiant.
D'après la « Biographie de Zhang Sanfeng » insérée
dans l'Histoire officielle des Ming (Mingshi), ce personnage aurait vécu
du XIIe siècle au XIV-XVe siècle, soit plus de 200 ans. «
Il était grand, d'imposante apparence, il portait les signes classiques
de longévité, c'est-à-dire ceux de la tortue et de la grue.
Il avait de grandes oreilles et des yeux ronds. Sa barbe se hérissait
furieusement comme la lame d'une hallebarde. Eté comme hiver, il portait
un simple vêtement. » Il était très versé dans
l'alchimie intérieure, et plusieurs ouvrages apocryphes sur cette dernière
discipline, datant de la fin du XIX' siècle, lui sont attribués
(14).
Plusieurs facteurs peuvent expliquer le choix de Zhang Sanfeng comme créateur
du Taiji quan. Le premier est celui que nous avons exposé ci-dessus,
à savoir l'habitude chinoise d'attribuer à un personnage éminent,
dont la biographie est écrite sur le modèle type des sages taoïstes
mais aussi des sages de l'antiquité, une invention. Le deuxieme facteur
est le lien intime entre Zhang Sanfeng et le mont Wudang, lieu de pèlerinage
consacré à Zhenwu le « Guerrier véritable »
et centre de développement des rituels militaires. Enfin, l'on a probablement
voulu opposer un saint taoïste à l'éminent moine bouddhiste
Bodhidharma à qui est attribuée la création des techniques
de combat Shaolin. Certains des maîtres de Taiji quan que nous avons rencontrés
dénient même la paternité du Taiji quan à Zhang Sanfeng,
considérant qu'il a seulement modifié le Shaolin quan (15). Selon
cette hypothèse, alors que Zhang Sanfeng se rendait dans le Sichuan,
il se serait arrêté en chemin au temple Shaolin de la province
du Henan pour y apprendre les techniques de combat et n'aurait étudié
le taoïsme qu'ultérieurement, par l'intermédiaire des arts
martiaux. S'étant rendu compte que les moines de Shaolin faisaient un
emploi excessif de la force musculaire, entrainant ainsi une déperdition
d'énergie originelle, il aurait cherché un moyen de pallier cet
inconvénient et aurait ainsi crée le Taiji quan (dont les principes,
comme nous le verrons, sont orientés vers une conservation de l'énergie).
Les défenseurs de cette théorie se fondent sur la similitude de
quelques mouvements du Taiji quan et du Shaolin quan. Mais l'on peut penser
aussi que ces deux techniques ont fait des emprunts au fonds commun des techniques
de combat millénaires en Chine.
(8) Zhenwu, le « Guerrier véritable », est
le protecteur armé du monde, qui siège dans l'étoile polaire.
Plusieurs textes du Canon taoïste le concernent, dont les N°
27 (27), 556 (775), 530-531 (754), 567 (816), 608 (960), 879 (1213) etc.
(9) Sur Zhang Sanfeng, voir « A taoist immortal of the Ming dynasty, Chang
San-fung » d'Anna Seidel dans Self and society in Ming thought.
Les biographies de ce personnage abondent.
(10) Selon d'autres versions ; c'est un moineau.
(11) Cette légende est rapportée notamment dans Taiji quan
shiyi de Dong Yingjie, p. 7.
(12) Sur le pas de Yu, voir de M. Kaltenmark « Les danses sacrées
en Chine » dans les Danses sacrées, p. 444. Une des descriptions
les meilleures et les plus détaillées de ce pas se trouve dans
le Baopuzi neipian, juan 11 (IV' siècle). Il est le pas de base
de tous les rituels taoïstes, encore à l'heure actuelle. Mais il
avait aussi une fonction exorciste et thérapeutique. Ainsi, parmi les
documents médicaux excavés de la tombe N° 3 de Mawangdui et
qui dateraient du IV' s. av. J.-C., l'un d'eux auquel fut donné le titre
de 52 recettes thérapeutiques comporte à plusieurs reprises
l'usage du pas de Yu pour guérir le malade, lequel pas est effectué
dans des directions différentes selon la nature de la maladie.
(13) Tiré de la « Biographie de Zhang Songxi » dans Ningbo
fuzhi vol. 4, p. 2 289.
(14) Zhang Sanfeng dadao zhiyao et Zhang Sanfeng taiji liandan mijue.
(15) Thèse rapportée dans Zhang Sanfeng he tade Taiji quan
de Li Ying-ang.
3. DISTINCTION ÉCOLE EXOTÉRIQUE-ÉCOLE ÉSOTÉRIQUE
Cette distinction est déja attestée dans « L'épitaphe
à Wang Zhengnan » écrite au XVII' siècle par Huang
Lizhou (16) : « Shaolin est célèbre dans tout l'empire pour
la bravoure de ses gens grâce à leur technique de combat qui consiste
principalement à lutter avec l'adversaire ; c'est pourquoi ce dernier
peut parfois l'emporter. Mais il existe aussi une école dite école
ésotérique, qui a pour principe de neutraliser la force dynamique
par le pouvoir de la tranquillité. Dans la lutte, ils jettent immédiatement
à terre leur adversaire. En opposition à cette école, qui
commence probablement à partir de Zhang Sanfeng de la dynastie des Song,
l'école Shaolin a été appelée école exotérique.
»
D'après la majorité des maîtres de Taiji quan, la distinction
entre ces deux écoles correspondrait à celle entre « travail
intérieur » (neigong) et « travail extérieur
» (waigong), distinction apparue dans plusieurs ouvrages sur les
exercices de longévité à partir de la dynastie des Ming
(1368-1644). Ainsi, les techniques de l'école ésotérique
insisteraient davantage sur le travail intérieur consistant à
exercer le souffle, tandis que les techniques de l'école exotérique
s'appuieraient plutôt sur l'effort musculaire. Cette explication reste
toutefois insuffisante, si ce n'est inexacte, dans la mesure où le travail
intérieur n'est pas totalement négligé dans les techniques
de l'école exotérique.
Une autre hypothèse avancée est que « école ésotérique
» (neijia) désignerait ceux qui restent dans leur famille,
c'est-à-dire les taoïstes qui pour la plupart pouvaient fonder une
famille et n'étaient pas obligés de mener une vie érémitique,
par opposition à « école exotérique » (waijia),
ceux qui sortent de leur famille, expression désignant les moines allant
vivre dans les monastères bouddhiques. Autrement dit, l'école
ésotérique correspondrait au courant taoïste, et l'école
exotérique au courant bouddhique.
Enfin Li Ying-ang, auteur contemporain de plusieurs ouvrages sur le Taiji quan
(17), donne une autre interprétation de cette distinction non pas entre
école ésotérique et école exotérique, mais
entre courant Wudang et courant Shaolin. Selon lui, l'expression « courant
Wudang » aurait été forgée sous les Qing et répandue
par les milieux du Palais Impérial, ou le Taiji quan a été
enseigné. L'impératrice Ci Xi y fut elle-même initiée,
et ranima et soutint les milices locales par trois édits (du 5-11 1898,
31-12 1898 et 17-03 1899). En établissant cette distinction, les milieux
impériaux auraient cherché à dresser le courant Wudang
contre le courant Shaolin, qui participait à maintes activités
subversives contre le
pouvoir des Qing et représentait un danger réel, alors que, comme
nous le verrons, les adeptes du Taiji quan ont effectivement participé
à la répression de rébellions locales.
(16) Dans Huang Lizhou wenji de Huang Zongxi (1610-1695),
éd. pekin 1959, p. 145.
(17) Dans Zhang Sanfeng he tade Taiji quan de Li Ying-ang.
4. AUTRE ORIGINE DU TAIJI QUAN
...Song Yuanqiao, célèbre taoïste de la fin de la dynastie
des Tang... serait l'auteur d'un ouvrage que possédait Song Shuming,
les Différents courants et l'origine de la méthode du Taiji
transmise par la famille Song...
Le même ouvrage rapporte une autre tradition, faisant remonter le Taiji
quan à Li Daozi (21) de la dynastie des Tang. La méthode qu'il
pratiquait ne se serait pas appelée Taiji quan, mais Xiantian quan (technique
du ciel antérieur) (22). Sous la dynastie des Song, cette technique aurait
été transmise à la famille Yu, puis à Song Yuanqiao,
Yu Lianzhou et Zhang Songxi. Enfin, une autre technique, intitulée les
« Treize postures du Taiji » aurait été transmise
à partir de Zhang Sanfeng.
Song Shuming eut pour disciples d'éminents maîtres de Taiji quan.
Après s'être affrontés à lui, nombre de ces maîtres
reconnurent sa supériorité et devinrent ses disciples. Citons
parmi les plus célèbres Xu Yusheng (1878-1945), Wu Jianquan, et
Ji De.
Quelques maîtres contemporains sont convaincus de l'authenticité
du livre de Song Yuanqiao...
(21) Li Daozi vécut sous les Tang (618-905) à Anqing
dans le Jiangnan. Il résida sur le mont Wudang.
(22) L 'expression « ciel antérieur » désigne ce qui
précède la création, ce qui est inné, par opposition
à « ciel postérieur », ce qui est après la
création, ce qui est acquis.
c) Autre fondateur présumé : Wang Zongyue
Selon un texte très bref intitulé Traité de la lance
Yinfu (28), la création du Taiji quan serait antérieure à
Chen Wangting et serait due à un dénommé Wang Zongyue de
la province du Shanxi. Ce dernier aurait enseigné le Taiji quan à
Jiang Fa, lequel en passant par Chenjiagou aurait transmis le Taiji quan à
la famille Chen. Cette tradition à été répandue
après la découverte par Wu Yuxiang du Traité de la lance
Yinfu et d'un Traité sur le Taiji quan (Taiji quan ling) du
même auteur : Wang Zongyue. Les quelques personnes qui se sont rendues
à Chenjiagou au début du siècle, notamment Tang Hao qui
y séjourna de 1928 à 1935 pour faire des recherches historiques
sur le Taiji quan, n'ont pas entendu parler de Wang Zongyue. Il est un fait
que la famille Chen avait intérêt à dissimuler l'apport
d'une technique de l'extérieur, s'il y en a eu un. Mais il était
tout autant dans l'intérêt de Wu Yuxiang de « découvrir
» une tradition plus ancienne, et de donner ainsi du prestige à
son école. Selon Zeng Zhaoran, qui a écrit une histoire du Taiji
quan, cette tradition serait vraisemblable, mais I'origine en serait une confusion
entre Wang Zongyue et Wang Zong, célèbre boxeur (29).
(28) D'après la préface de ce Traité
sur la lance Yinfu trouvé par Wu Chengqing, frére de Wu Yuxiang,
Wang Zongyue aurait vécu à Luoyang la 56ème année
du règne de l'empereur Qianlong (1791) et aurait déménagé
à Kaifeng en 1795. En passant par Chenjiagou, il aurait fait des remarques
aux villageois sur leur méthode de boxe et ceux-ci auraient accepté
de modifier certains points.
(29) Wang Zong est mentionné dans le Dictionnaire biographique comme un boxeur célèbre.
table des matières artmartial.com
Bilbliographie
de Catherine Despeux :
- Prescriptions
d'acupuncture valant mille onces d'or : Traité d'acupuncture de Sun Simiao
du VIIe siècle
- Le
chemin de l'éveil
- Immortelles
de la Chine ancienne
- Soûtra
de l'Eveil parfait (Yuanjue jing) et Traité de la Naissance de la foi
dans le Grand Véhicule (Dasheng qixin lun Mahaynasraddhotpadasastra)
: Version chinoise de Buddhatrata et Paramartha
- La
quète de l'immortalité en chine
- La
Moëlle du phénix rouge : Santé et longue vie dans la Chine
du XVIe siècle
- Taoïsme
et corps humain : Le Xiuzhen tu
- Traité d’alchimie et de physiologie taoïste. Weisheng Shenglixue
mingzhi de Zhao Bichen (Edition des deux océans)
- Les Entretiens de Mazu. Maître Chan du VIIIe siècle (Edition
des deux océans)
Carte de la Chine :
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:China_relief_2001.jpg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:China-Henan.png
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Historicalcapitalsofchina_ancient.png
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:SacredMountainsofChina.jpg
monastère Shaolin, Song Shan
- http://en.wikipedia.org/wiki/Image:China-Hubei.png
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Map-World-East-Asia.png
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Indiamap-mo.jpg
- Chronologie_des_dynastie_Chinoise
(wikipedia)
- Table
de correspondance pinyin - EFEO (Ecole française d'Extrême-Orient)
pinyin-efeo
- Généalogie : lignées du
Taiji quan
note : selon un élève de Yang ShaoHou, Yang Luchan découvrit
un vieux grimoire traitant du Taiji quan originel et après l'avoir lu,
il comprit que ce qui lui avait été enseigné avait quelque
peu dévié. Yang Shaohou était le frère de Yang Chengfu
et le maître de Chen Panling. Chen Panling présidait le comité
de l'académie nationale des arts martiaux de Nan-King en 1929 qui créa
le style "Ortodoxe de Taiji quan" à partir des écoles
de Taiji quan : Chen (Chen Fake), Yang (Yang Chengfu), Wu (Wu Jianquan), Wu
(Hao : Guo Weizhen), Sun (Sun Lutang) et des écoles de Xingyi quan et
Bagua zhang (lignée Chung-nan : Wang Shujin). Chen Panling était
expert de Xingyi quan et de Bagua zhang, il pratiqua les écoles Chen
et Wu (Wu Jianquan) de Taiji quan mais a surtout étudié la vielle
école Yang avec Yang Shaohou.

Lao-tseu
de Catherine Despeux
Présentation de l'éditeur : Lao-tseu (ou Laozi), le Vieux Maître, est une grande figure de la pensée chinoise, un sage dont l'historicité s'efface derrière la légende. Mais il est aussi un personnage important du taoïsme, divinisé sous le titre de Très Haut Seigneur Lao et qui, bien que représenté sous forme humaine, procède en réalité du chaos primordial, se confond avec l'origine des choses et manifeste de temps à autre des signes pour guider le monde. Au cours des siècles, sa pensée a exercé une influence considérable dans toutes les couches de la société chinoise et dans des milieux très divers : gens des campagnes, artisans et commerçants, ermites, lettrés, militaires, religieux, artistes, médecins, empereurs, impératrices et. plus récemment, spécialistes d'arts martiaux et maîtres de qi gong. Ses adages servent à la connaissance de soi, mais aussi dans l'art de la guerre, l'exercice de l'autorité, l'art de rester en bonne santé et la recherche du bien-être. Guide de l'insondable, Lao-tseu montre le chemin vers l'ineffable Voie et apprend à palper la respiration du monde. Il propose une philosophie de l'agir sans interférer dans le cours des choses, un cheminement vers la connaissance de soi pour oeuvrer dans le monde. Le sage protège son souffle, conserve sa puissance spirituelle et maintient l'intégrité de son être, afin que la sagesse qui en découle lui permette de trouver la Voie mais aussi de servir autrui.
Biographie de l'auteur : Catherine Despeux, professeur émérite à l'INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales), travaille sur l'histoire de la médecine chinoise et du taoïsme. Elle s'est spécialisée dans l'étude des techniques taoïstes du corps, du souffle et de l'esprit (2010).

Taoïsme et connaissance de soi : La carte de la culture de la perfection (1Cédérom)
de Catherine Despeux
Présentation de l'éditeur : Dans le taoïsme, la connaissance de soi passe par celle de son corps et de son intériorité. Sexualité, gymnastique, respiration, visualisations, contemplation, sont autant de chemins vers la découverte de son âme que le taoïsme propose. Depuis le XIe siècle, il existe des représentations du corps et de ses constituants psychiques, qui servent de support aux méthodes précitées que l'on appelle alors "alchimie intérieure" (neidan). La représentation la plus répandue actuellement est la Carte de la culture de la perfection (Xiuzhentu) (XIXe siècle), thème central de cet ouvrage. Catherine Despeux étudie l'évolution historique de ces cartes avec leur symbolisme hermétique qui plonge ses racines dans les grands textes classiques du Canon taoïste. Elle les déchiffre, en décrypte les symboles et présente en même temps les principaux lieux du corps intervenant dans les techniques de qi gong et de méditation taoïste. Elle décrit le corps considéré dans le taoïsme comme un petit monde en soi, un paysage intérieur, la résidence de divinités et de forces psychiques, le domaine des paradis et des enfers, le lieu de transformation pour accéder à la perfection, au réel. Cet ouvrage est une édition revue et augmentée de Taoïsme et corps humain paru en 1994.
Biographie de l'auteur : Catherine Despeux, professeur émérite à l'INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales), est l'auteur de nombreuses publications sur l'histoire de la médecine chinoise, le bouddhisme et le taoïsme. Elle s'est spécialisée dans l'étude des techniques du corps, du souffle et de l'esprit. Elle a parcouru les célèbres montagnes de Chine et rencontré des pratiquants taoïstes, hommes et femmes, depuis le Mont Fleur (Huashan) près de Xi'an, montagne escarpée ayant inspiré de grands peintres chinois, les monts Wudang (Hubei), jusqu'au Pic du sud (Hengyue) dans le Hunan, grand centre historique des femmes taoïstes (1994-2012).
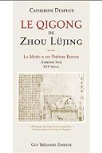
Le Qigong de Zhou Lüjing : La moelle du Phénix Rouge (Chiffeng Sui) XVIe siècle
de Catherine Despeux
Présentation de l'éditeur : De nos jours, le Qigong s’est répandu au point de supplanter des techniques comme le yoga ou la sophrologie. Pourtant, rares sont les pratiquants qui en connaissent vraiment l’origine et sont conscients de la diversité des méthodes que recouvre cette pratique. L’ouvrage qui est ici traduit, La Moelle du phénix rouge, présente des procédés de Qigong traditionnel réunis à la fin du XVIe siècle par Zhou Lüjing. On ne peut trouver meilleur exemple de la richesse et de la diversité de cet Art ancestral, visant à harmoniser le corps, le souffle et l’esprit.
Biographie de l'auteur : Catherine Despeux est l'une des plus grandes spécialistes du taoïsme, professeur émérite à l'INALCO. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages et articles dont l'incontournable Taiji Quan, art martial, technique: de longue voie (2011).
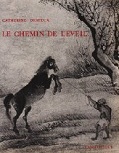
Le chemin de l'éveil
de Catherine Despeux
Quatrième de couverture :
La terre du Coeur s'exprime selon les circonstances,
L'éveil n'est qu'apaisement.
Les phénomènes et l'Absolu sont sans obstruction,
Il y a simultanément production et non-production.
Le thème du dressage d'un animal a servi à illustrer comment une personne en quête spirituelle doit s'y prendre pour dompter sa nature et parvenir à l'éveil. Le dressage de l'éléphant n'illustre qu'une partie du chemin de l'éveil, celle qui mène à l'équanimité, et ses rapports avec le dressage chan du buffle ne sont pas connus.
Il a existé plusieurs versions du dressage du buffle en plusieurs étapes (quatre, six, huit, dix ou douze), certaines mettant l'accent sur l'aspect progressif du cheminement, d'autres mettant en relief l'identité des phénomènes et de l'Absolu.
La version du dressage du cheval est due à un adepte du Quanzhen, école taoïste très imprégnée de bouddhisme chan, mais exprimant aussi des notions communes au taoïsme philosophique et au chan, telle que la notion de simplicité et de spontanéité illustrée par ces deux vers du dressage du cheval :
La grande Voie ne nécessite ni ingéniosité ni habileté,
Il suffit de boire quand on a soif, manger quand on a faim
se reposer quand on est fatigué (1981-1992).